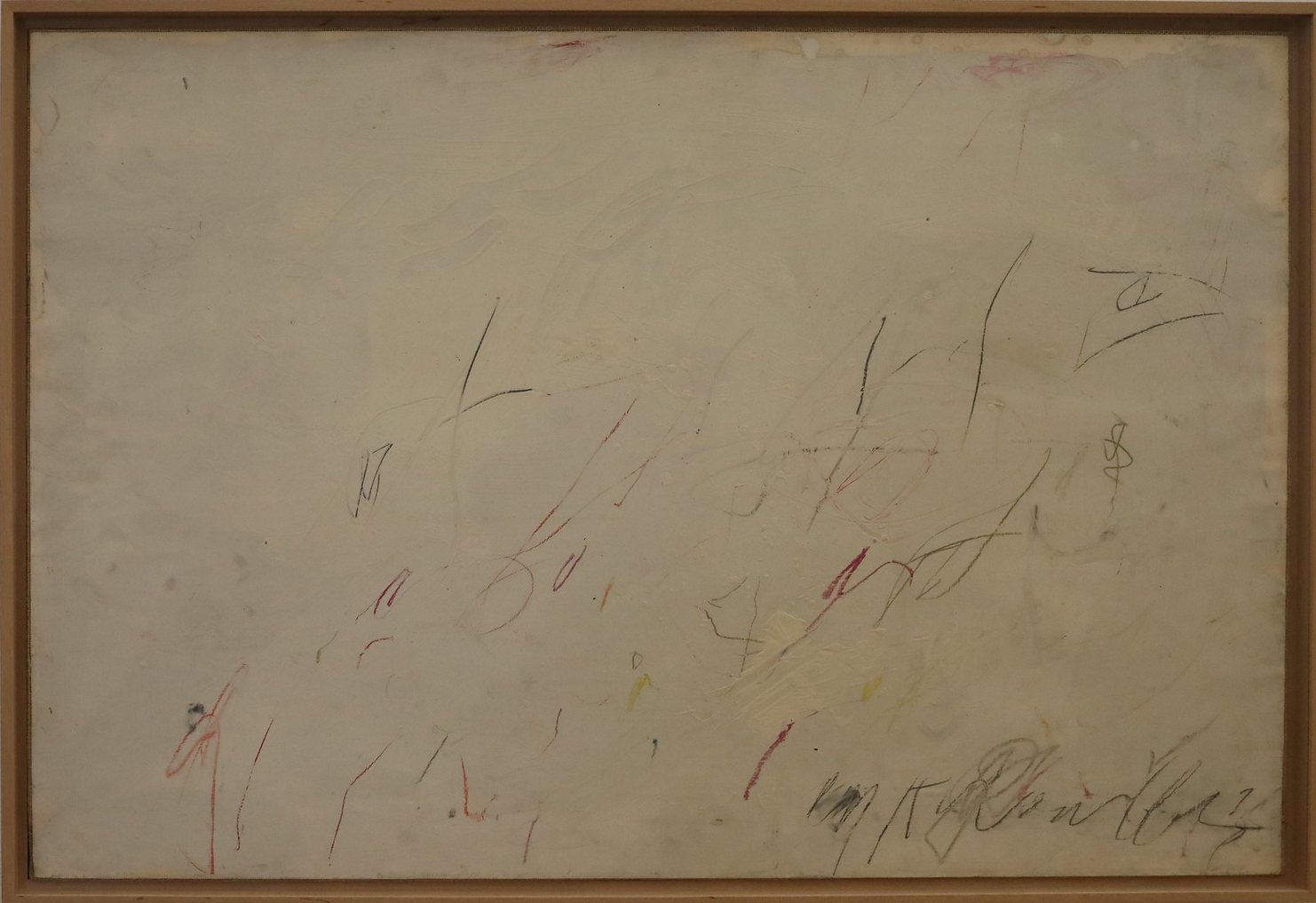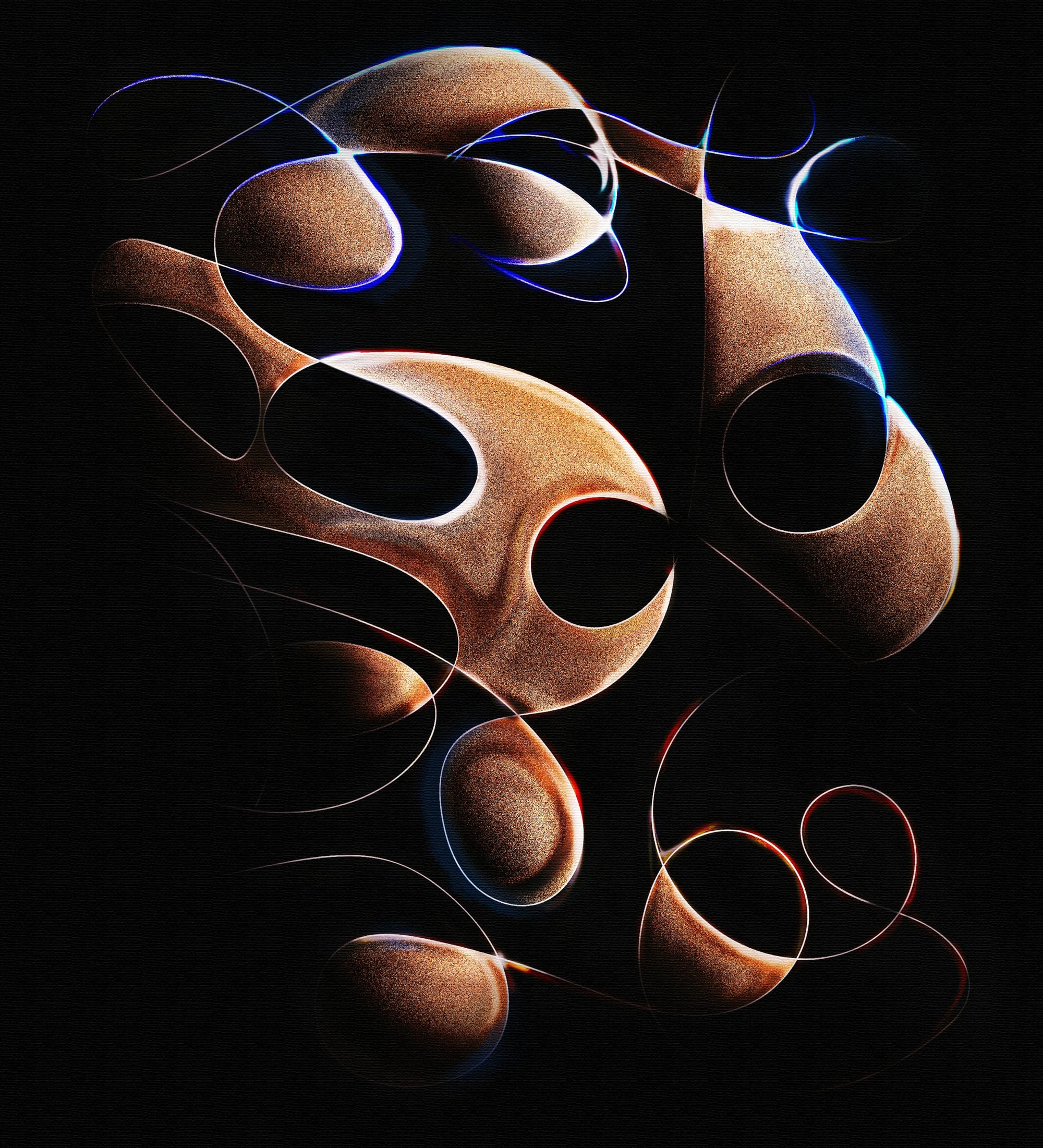Rompre avec les habitudes du regard pour penser le monde en mouvement, c’est ce que nous propose Janine Guespin-Michel dans son article « La pensée dialectique du complexe », publié sur le site du Réseau Salariat. Entre la logique formelle qui fige, oppose et sépare, et une pensée capable d’accueillir les contradictions vivantes, la chercheuse esquisse une voie : celle d’une intelligence des transformations qui ne nous fige ni dans une posture savante, ni dans un système fermé, mais nous incite à une exigence pratique pour habiter autrement les tensions du présent.
Pour ce faire, elle interroge les limites de la pensée occidentale dominante, héritée d’Aristote, de Descartes et des mathématiques linéaires. Jugée binaire, réductionniste et statique, cette façon de nous représenter le monde nous empêcherait de comprendre la réalité comme un tissu d’interactions mouvantes et ce faisant serait devenue un obstacle politique à toute transformation. Contre cela, l’autrice défend une alternative : la pensée dialectique du complexe. Croisant la dialectique matérialiste et les apports récents des sciences de la complexité, elle ne propose pas un système, mais une pratique intellectuelle capable de penser les transformations, les contradictions actives, les boucles de rétroaction, les émergences. « Comprendre » ne signifie alors plus décomposer, mais voir les rapports, les tensions, les dynamiques ; et les intégrer ajouterais-je. On note au passage que cette conception rejoint le sens latin originel du mot comprendre/cum-prehendere — composé de cum « avec » et prehendere « prendre, saisir » ; littéralement « saisir ensemble, embrasser quelque chose, entourer quelque » d'où « saisir par l'intelligence, embrasser par la pensée ».
« La pensée dialectique est la logique des transformations et des contradictions. Elle permet précisément de penser les comportements complexes. »
Comment entrer dans cette méthode de pensée ? Si nous renvoyons naturellement à l’article où la chercheuse esquisse plusieurs étapes ; en voici l'aperçu. La première consiste à décentrer le regard, à prendre en compte les interactions au sein d’un tout : non pas « analyser », mais articuler ; c’est déjà penser autrement. La seconde, plus fine, vise à reconnaître les contradictions dialectiques et les rétroactions (boucles) qui permettent d’anticiper les métamorphoses possibles d’un système.
« Les contradictions dialectiques se caractérisent par l’unité de couples que la logique formelle considère comme irréductibles. La vie est à la fois la mort, et ce qui s’y oppose. »
Quand la mayonnaise prend... entre les disciplines
Microbiologiste de formation, l’autrice prend l’exemple de la mayonnaise (un mélange fluide qui devient gel sous l’effet d’une agitation critique) pour illustrer comment une transformation qualitative peut émerger d’un seuil atteint dans un système en interaction. Selon les disciplines scientifiques invoquées, on appelle cela un changement de phase, une bifurcation, ou une émergence auto-organisée. Dans le cas de la mayonnaise (ou d’autres systèmes analogues), le « processus global n’est pas dirigé par une molécule chef ni par une organisation hiérarchique, il est auto-organisé » indique-t-elle.
Au final, la chercheuse invite ainsi à sortir des silos, à renoncer au réflexe manichéen pour retrouver le sens du mouvement intellectuel. Que ce soit dans les domaines politiques, écologiques, éducationnels, cette pensée du complexe devient aujourd’hui une nécessité vitale pour ne pas être emporté par ce que l’on ne comprend plus.